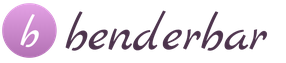Protestants russes. Églises protestantes modernes en Russie
Le protestantisme est populaire en Russie.
On ne l’appelle pas toujours directement protestantisme et ce n’est pas toujours radical, mais les idées du protestantisme sont populaires.
Premièrement, l'idée de clarifier les livres liturgiques, de réviser la partie rituelle selon son sens est l'idée des protestants en Europe, et la même idée a été mise en œuvre en Russie. Cela a provoqué une scission et l'émergence de mouvements de vieux croyants.
Deuxièmement, l'idée d'initier les gens à la Bible est une idée protestante fondamentale (non pas dans le sens où elle est étrangère aux catholiques et aux chrétiens orthodoxes, mais dans le fait que ce sont les protestants qui l'ont soulevée et mise en œuvre et c'était l'essence de leur protestation - un retour à la Bible). Cette idée est également venue en Russie et a été mise en œuvre. De plus, il est venu précisément avec les protestants d'Europe.
Au début du XIXe siècle, une Société biblique a été créée en Russie, sur le modèle des nombreuses sociétés bibliques protestantes européennes les plus populaires, dont le but était d'initier les gens à la Bible et de transformer la vie conformément à elle. C’est exactement ainsi qu’a été achevée la traduction russe de la Bible, approuvée par le Synode et connue sous le nom de traduction synodale. Avant cela, les gens utilisaient la traduction slave de l'Église. Ce qui, avec l'application du travail, est également compréhensible, mais l'accessibilité de la traduction russe et la facilité de publication sont encore beaucoup plus élevées.
La culture religieuse de la Russie du début du XIXe siècle au début du XXe est impensable sans une compréhension du protestantisme. Léon Tolstoï, qui est-il sinon protestant ?! La purification de la vie et de la foi selon la Bible, la traduction de la Bible sont ses idées principales et c'est précisément le protestantisme. Pour comprendre, lisez l’histoire de son principal allié Chertkov. L'une des personnes les plus riches de Russie, proche de l'empereur, fut élevée spirituellement par un protestant anglais venu en Russie, Grenville Redstock. Son cercle comprenait les princesses N.F. Lieven, V.F. Gagarina, le comte A.P. Bobrinsky, le comte M.M. Korf, le colonel V.A. Pashkov, Yu.D. Zasetskaya. Lisez "Anna Karénine" - Tolstoï y décrit ce système de cercles spirituels qui englobait de nombreux membres de l'élite russe. Les baptistes et les pentecôtistes de Russie appellent ses activités le « Grand Réveil » ; cela a donné une impulsion aux activités de prédication et de publication des protestants dans toute la Russie.
En 2014, les érudits religieux parlent de 3 millions de protestants en Russie. (sov-europe.ru) Et ce qui est important, ce ne sont pas seulement des millions d'orthodoxes qui s'attribuent à la culture orthodoxe, mais ne fréquentent pas l'église, mais des communautés protestantes actives. Ce nombre est comparable au nombre de chrétiens orthodoxes qui fréquentent régulièrement l'église : selon diverses enquêtes, ils seraient jusqu'à 12 millions. "Les églises protestantes d'Ouralsk, Quartiers sibériens constituent une partie importante de toutes les associations, et dans le district d'Extrême-Orient, leur nombre dépasse le nombre de chrétiens orthodoxes." (à partir du lien ci-dessus, il s'agit de données du ministère de la Justice sur les communautés enregistrées)
La vérité sur les protestants
Avons-nous vraiment une autre Église que la nôtre, l’Orthodoxe ? - m'a demandé un jour le chef de l'administration d'une petite ville de la région de Moscou après que je me sois présenté à lui comme le pasteur de l'Église chrétienne adventiste du septième jour.
Nous pouvons entendre assez souvent des questions similaires de la part de diverses personnes. Il s'agit d'une certaine attitude idéologique qui s'est développée récemment dans notre pays et popularisée par les médias. Ils tentent de nous convaincre que la Russie est un pays originellement et totalement orthodoxe et que les Russes n’ont jamais professé aucune autre religion. Aujourd’hui, les mots russe et orthodoxe sont synonymes dans de nombreux esprits. Pour la majorité, être un véritable patriote de la Russie signifie être orthodoxe. Les protestants sont donc perçus comme une sorte d’élément étranger amené de l’Occident au cours des dix à quinze dernières années, de sorte que – ni plus, ni moins ! - pour saper la foi russe, la foi orthodoxe, et avec elle - oh horreur ! - et les fondements de l'État russe lui-même.
Mais vraiment, les protestants russes ont-ils le droit de considérer leur foi, comme ils le prétendent eux-mêmes, comme traditionnelle avec les orthodoxes, et eux-mêmes - à cet égard - comme des Russes à part entière ? En effet, dans l’atmosphère actuelle, dès qu’un citoyen russe devient membre d’une église protestante, il doit immédiatement se poser la question : est-il toujours le maître légitime de son propre pays ou est-il devenu un hôte varègue ? Et en général, un protestant en Russie n'empêche-t-il pas sa foi d'être patriote et soucieux de la prospérité de son pays ? Si vous croyez l’opinion populaire, alors elle interfère vraiment !
À la recherche d'une réponse à ces questions douloureuses, l'auteur s'est tourné vers l'histoire de l'État russe - les recherches d'éminents scientifiques russes, dont le domaine d'intérêt était l'histoire des protestants dans notre pays. Notons au passage que les études évoquées par l'auteur de l'article peuvent contenir des interprétations de faits historiques différentes de celles généralement connues. Toutefois, cela ne signifie pas qu’ils sont incorrects. Il ne faut pas oublier que l'histoire est parfois présentée de telle manière qu'elle correspond à une certaine idéologie, étouffant les faits qui ne rentrent pas dans le lit procustéen des vues généralement acceptées. Ainsi, dans cet article, le lecteur découvrira d'étonnantes découvertes de l'histoire de la Patrie, jusqu'alors peu connues, car cachées au public. Mais il n’y a rien de secret qui ne devienne évident.
Le protestantisme est arrivé sur un navire marchand
Les premiers protestants sont apparus en Russie dans les années 20. XVIe siècle, presque simultanément avec le mouvement de réforme en Europe. Au début, il s'agissait d'étrangers qui vivaient en communautés fermées et n'exerçaient pratiquement aucune activité missionnaire auprès des Russes. Au fil du temps, de nombreux invités commerciaux et leurs descendants se sont enracinés et ont accepté la citoyenneté russe. Ainsi, le protestantisme a commencé à passer d’une religion « étrangère » à la religion du peuple indigène de Russie.
Les tout premiers protestants étaient des marchands luthériens des villes d'Allemagne du Nord, principalement Hambourg et Königsberg, qui entretenaient depuis longtemps des relations commerciales avec Novgorod et Moscou. Les luthériens sont également venus en Russie depuis la Suède qui, grâce à l'influence des prédicateurs suédois de la réforme de l'Église Olaf et Lawrence Petri et avec le soutien du roi Gustav Vasa, qui a adopté le protestantisme, a été l'un des premiers pays d'Europe du Nord à adopter Le protestantisme comme religion d'État1.
En 1524, un traité de paix fut conclu entre la Russie et la Suède, les marchands suédois reçurent le droit d'établir une maison de commerce à Veliky Novgorod et de commercer dans toute la Russie.
En 1553, les marchands anglais ouvrirent une route commerciale vers la Russie à travers la mer Blanche et créèrent deux ans plus tard la Société commerciale de Moscou (russe), dont les membres obtinrent le droit d'entrée libre et le droit de commerce hors taxes dans tout le pays par la Russie. Tsar. Après les Anglais en 1565, les Hollandais arrivèrent. À Kholmogory et Arkhangelsk, où se sont installés des marchands et des constructeurs navals, des communautés anglicanes et réformées se sont formées. En 1559, les marchands de la Compagnie anglo-russe reçurent une charte royale, qui leur permettait d'accomplir des offices protestants en leur sein et interdisait aux autorités russes de les contraindre à se convertir à l'Orthodoxie2. En 1558-1581 La ville de Narva, annexée à l'État de Moscou, devient un centre commercial majeur avec les Allemands, les Danois, les Anglais, les Écossais, les Hollandais, en un mot, avec toute l'Europe protestante.
Après que Moscou ait conquis les khanats de Kazan et d'Astrakhan, des caravanes marchandes d'Europe et des pays de l'Est ont commencé à arriver en Russie le long de la Volga. Les marchands protestants ont commencé à s'installer dans les villes de la région de la Volga (Nijni Novgorod, Kazan) à partir de la seconde moitié du XVIe siècle.
Les tsars russes invitaient volontiers à leur service des étrangers - médecins, architectes et autres spécialistes, dont beaucoup professaient également le protestantisme. Mais Ivan III commença à inviter les catholiques à Moscou. Cependant, les pays catholiques, craignant le renforcement de la Russie, ont empêché les relations commerciales entre leurs autochtones et Moscou. Et les Moscovites ne les honoraient pas particulièrement. Craignant l’influence de Rome, l’Église orthodoxe russe a créé l’image la plus défavorable aux catholiques. On les surnommait « les damnés Latins, les papejniks ». Les catholiques de Russie sont devenus particulièrement mal à l'aise après les événements liés à la conclusion en 1439 de l'Union ferraro-florentine entre Constantinople et Rome. Constantinople avait besoin d’un allié fort dans la lutte contre les Turcs, c’est pourquoi l’accord a été conclu aux conditions de Rome, ce que Moscou a perçu comme un retrait de Constantinople de l’orthodoxie et une agression de Rome, qui cherchait à dominer religieusement l’Est. En conséquence, est née la doctrine « Moscou est la troisième Rome », avancée en 1523 par Philothée, un érudit moine du monastère de Pskov.
Tout cela oblige les Moscovites à rechercher les spécialistes dont l’État a besoin dans les pays protestants d’Europe. Au cours des dernières années du règne du grand-duc Vassili Ivanovitch, de nombreux médecins, pharmaciens, commerçants, artistes et artisans sont arrivés à Moscou de l'étranger, que nous avons commencé à appeler, quelle que soit leur nationalité, « Luthors » ou « Allemands ». Sous Ivan le Terrible, il y avait encore plus de spécialistes protestants étrangers. À Moscou, ils se sont installés de manière compacte, d'abord à Varvarka, avec leurs familles, serviteurs et apprentis, également protestants. À cette époque, des communautés protestantes s'étaient formées dans d'autres villes russes - Vladimir, Ouglitch, Kostroma, Tver3.
Les protestants sont les ambassadeurs de la civilisation occidentale
On suppose qu'Ivan le Terrible favorisait les protestants et entamait souvent des discussions théologiques avec eux. On connaît au moins deux tentatives pour intéresser Ivan le Terrible au protestantisme précisément à partir d'une position missionnaire (avec l'espoir qu'après avoir accepté la nouvelle foi, il y conduirait son peuple). Ainsi, en 1552, le roi danois Christian III, luthérien, envoya l'imprimeur Hans Messingheim à la cour de Moscou avec une proposition de traduire en russe et d'imprimer la Bible et les livres décrivant la foi protestante. Une autre fois, lors du Conseil réformé de Bihava (1550), il fut décidé d'envoyer à Moscou deux missionnaires du Royaume de Pologne-Lituanie. Et en 1570, les missionnaires faisaient partie d'un groupe de diplomates envoyés à Moscou par le roi polonais Sigismond II Auguste. Officiellement, la tâche des ambassadeurs était de négocier l'établissement de relations amicales entre la Russie et la Pologne. Mais certains membres de l'ambassade avaient pour ordre secret de veiller au rapprochement avec l'Église orthodoxe et de tenter d'intéresser le souverain lui-même au protestantisme. Un membre de l'ambassade, pasteur de la communauté des frères de Bohême, Ivan Rokita, un Slave, a communiqué avec Ivan le Terrible sans interprète. A l'issue des négociations officielles, un débat sur la religion s'engage entre eux en présence de l'ambassade, des boyards et du clergé4. Les tentatives visant à persuader Grozny d'adhérer au protestantisme ont échoué, mais elles témoignent d'une certaine influence que les protestants ont reçue à la cour dès le XVIe siècle.
Outre les marchands et les artisans, des spécialistes militaires, principalement des officiers, ont également été invités en Russie pour enseigner à l'armée russe les secrets de l'art militaire occidental. Sous le règne de Fiodor Ioannovich, fils d'Ivan le Terrible, 5 000 Allemands luthériens ont servi dans les troupes russes.
Boris Godounov a également appelé de nombreux artisans et techniciens allemands en Russie. Il a accordé un patronage spécial aux protestants qui ont fui vers la Russie depuis des pays Europe de l'Ouest depuis guerres de religion et une persécution brutale. Parmi eux se trouvaient des luthériens et des réformés. Au XVIIe siècle, pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), qui éclata en Europe, de nombreux réfugiés protestants émigrèrent en Russie.
Sous le règne de Mikhaïl Fedorovitch Romanov (1613-1645), des communautés protestantes allemandes existaient à Serpoukhov, Iaroslavl, Vologda et Kholmogory. Plus d'un millier de familles allemandes vivaient rien qu'à Moscou. Il existe des preuves que sous le fils de Mikhaïl Fedorovitch Alexei Mikhaïlovitch (père de Pierre Ier), il y avait jusqu'à 18 000 luthériens et calvinistes en Russie. Dans l'armée russe, 38 régiments d'infanterie et 25 régiments de Reiter étaient sous le commandement de chefs militaires allemands. À bien des égards, la Russie doit la formation de son armée aux protestants.
Le plus grand nombre de protestants sont arrivés en Russie sous le règne de Pierre Ier. Peter s'intéressait aux ingénieurs, techniciens et constructeurs navals hautement qualifiés - des spécialistes qui n'étaient disponibles à l'époque que dans les pays protestants d'Europe. En grande partie grâce aux spécialistes protestants, la Russie a fait un bond sans précédent dans son développement à l'époque de Pierre Ier, passant d'un État féodal médiéval à une puissance européenne avec laquelle l'Occident devait désormais compter.
Les protestants de Russie faisaient du commerce, construisaient des usines et des chantiers navals, participaient à la réforme de l'armée russe à l'européenne et contribuaient au développement de la culture et de l'éducation russes. Par exemple, sous le règne de Boris Godounov, une école allemande a été ouverte à l'Église luthérienne, dans laquelle étudiaient 30 étudiants, dont des Russes. Pasteur de la communauté luthérienne de Moscou, créée en 1662, Gottfried Gregory devient le fondateur du premier théâtre de Russie. 26 jeunes russes talentueux lui ont été confiés pour une formation en art théâtral. C'est grâce à leurs efforts que les premières représentations ont été organisées. histoires bibliques. Les représentations réunissaient la famille royale et les courtisans5.
Protestants - le soutien de Pierre le Grand
Sous le règne de Pierre Ier, l'afflux de protestants des pays baltes et d'Allemagne vers la Russie a augmenté, principalement issus de familles nobles, descendants de familles nobles. Beaucoup d'entre eux se sont installés en Russie, certains se sont convertis à l'orthodoxie, d'autres ont conservé la foi protestante, fondant ainsi de nouvelles communautés. Parmi eux et leurs descendants se trouvent des personnes dont la Russie est fière. Il s'agit des associés de Peter I, Y. V. Bruce et R. H. Bour ; les scientifiques L. Euler et GF Miller ; les hommes d'État N.H. Bunge et S. Yu. Witte ; Les décembristes P.I. Pestel et V.K. Kuchelbecker ; les navigateurs V.I. Bering, F.F. Bellingshausen et I.F. Krusenstern ; compilateur dictionnaire explicatif et le docteur V.I. Dal, les poètes A.A. Blok, M.Yu. Lermontov.
Les protestants sont également venus en Russie en tant que prisonniers de guerre. Ivan le Terrible fit particulièrement de nombreux prisonniers pendant la guerre de Livonie (1558-1583). Ceux d'entre eux qui possédaient des embarcations furent réinstallés dans les villes russes. C'est ainsi que des colonies allemandes furent formées à Moscou, Vladimir, Nijni Novgorod, Pskov, Veliky Novgorod, Tver, Kostroma et Ouglitch. Certains des prisonniers ont été livrés comme serfs, beaucoup ont été envoyés vivre dans les régions conquises des anciens khanats de Kazan et d'Astrakhan. Sous Pierre Ier, seulement après la défaite des Suédois près de Poltava, environ 15 000 soldats et officiers suédois furent capturés en captivité russe. Par lots de 100 personnes, ils ont été envoyés dans différentes villes des provinces d'Astrakhan, d'Arkhangelsk et de Kazan, 3 000 prisonniers ont été envoyés travailler à Voronej et plusieurs autres lots ont été envoyés au développement des terres sibériennes. Par son décret, Pierre a autorisé les Suédois à prendre des filles russes pour épouses, à condition toutefois qu'ils ne forcent pas leurs femmes à trahir la foi orthodoxe et s'est engagé à élever leurs enfants dans tradition orthodoxe. Pourtant, de nombreuses familles de prisonniers de guerre parviennent à rester fidèles au protestantisme.
Mais la plupart des protestants se sont retrouvés en Russie en raison de l'annexion des territoires occidentaux aux terres originellement russes. Par exemple, après la guerre du Nord (1700-1721), la Livonie, l'Estonie, l'île d'Ezel, l'Ingrie et une partie de la Finlande avec la ville de Vyborg sont passées en Russie. Dans tous ces lieux, la population professait le protestantisme. La Russie a mené une politique de tolérance religieuse envers les habitants des territoires annexés lors de batailles militaires et traités de paix. Il était interdit de convertir de force ces personnes à l’Orthodoxie ; leurs descendants vivent encore aujourd’hui en Russie7.
Catherine la Grande orthodoxe « protestante »
Et c'est ainsi que les protestants allemands sont apparus dans la région de la Volga. La princesse d'origine allemande Sophie Frédéric Auguste d'Anhalt-Zerbst, la future Catherine II, ayant épousé l'héritier du trône de Russie, s'est convertie à l'orthodoxie, mais ne s'est pas désintéressée de la foi protestante de ses anciens compatriotes. Devenue reine, elle commença à inviter des paysans et artisans allemands à résider de manière permanente en Russie pour développer les terres du sud et de la Volga. Les manifestes correspondants furent publiés en 1762 et 1783. Les colons se sont installés sur la Volga ; jusqu'à 25 000 d'entre eux sont arrivés dans la seule province de Samara8.
En 1774, à la suite de la victoire dans la guerre russo-turque, la Russie acquit la côte nord de la mer Noire et de la Crimée et la province de Tauride fut créée. Et là, pour développer de nouvelles terres, Catherine II invite les Allemands luthériens, mennonites et allemands réformés, connus pour leur haute culture agricole. Afin d'intéresser les immigrants d'Europe occidentale, Catherine, par décret de 1787, leur promet de nombreux avantages, dont la liberté de religion, l'exonération d'impôts et le service militaire pendant 10 ans. Le gouvernement a donné à chaque famille une allocation de 500 roubles, a alloué des charrettes pour le déménagement, a aidé à construire des maisons et a alloué 65 acres de terrain à une utilisation gratuite9. Le prince Potemkine de Tauride (le titre lui a été décerné pour la conquête de Tavria - Crimée) s'est personnellement rendu à Dantzig pour inviter des volontaires. Ainsi, 19 colonies mennonites ont été formées dans le sud de la Russie, dans lesquelles vivaient au moins 40 000 personnes. Les mennonites sont à juste titre considérés comme les prédécesseurs des baptistes et de l'adventisme en Russie. En tant que disciples du réformateur néerlandais Menno Simons, mentionné par Ellen White dans La Tragédie des Siècles10, les mennonites étaient les plus proches de l’Adventisme. Les premières communautés adventistes du sud de la Russie se sont formées précisément parmi les mennonites et les baptistes11. La colonisation de la province de Tauride et du sud de l'Ukraine par les protestants s'est poursuivie sous Paul Ier et Alexandre Ier.
Les colons se sont vu confier une tâche difficile : cultiver des terres vierges. Après cinq ans, les champs, les pâturages avec un grand nombre de bétail et les plantations de mûriers ont commencé à rapporter des bénéfices, les paysans sont devenus plus riches. Ils transportaient les produits de leurs fermes sur leurs propres navires à travers Odessa le long de la mer Noire jusqu'à Taganrog et les y vendaient. Ainsi, les protestants ont apporté une contribution significative au développement de l'économie du sud de la Russie. Le succès a accompagné les colons aussi parce qu'ils menaient un style de vie moral. Voici comment l'historien Varadinov écrit à ce sujet : « Dans les colonies mennonites, il n'y avait ni pubs ni tavernes du tout. Et ils avaient beaucoup moins de vacances que les orthodoxes. Ils se distinguaient par leur religiosité et valorisaient l’ordre et la précision.
Protestants populaires russes
Au XI Xe siècle. Population protestante des régions centrale et orientale Empire russe s'est développé grâce aux représentants de la noblesse, aux industriels et aux marchands des États baltes, arrivés en Russie pour des besoins publics et personnels. La plupart d'entre eux se sont installés à Saint-Pétersbourg, à Moscou et dans d'autres grandes villes. En outre, des paysans baltes et finlandais, également pour la plupart protestants, se sont installés en Russie à la recherche de terres gratuites.
Au milieu du 19ème siècle. Il y a eu une croissance sans précédent des mouvements protestants. Plusieurs raisons y ont contribué. Pendant longtemps, il a été interdit aux protestants de professer ouvertement leur foi et de s'engager dans une activité missionnaire, ce qui a conduit parmi eux à une stagnation spirituelle. Le protestantisme russe avait besoin d’être réveillé et renouvelé. A cette époque, la Russie connaît des réformes démocratiques initiées par Alexandre II, dont l'apogée est l'abolition du servage. Les réformes avancent cependant lentement, mais l’esprit de liberté a déjà infecté de nombreuses personnes. Les premiers capitalistes apparaissent en Russie pour remplacer les propriétaires fonciers. Les Russes apprennent les bases de l’économie capitaliste en Occident, où les pays protestants étaient les leaders du développement capitaliste.
En 1813, la Société biblique russe fut créée et commença à préparer une traduction de la Bible en russe. En 1822, l'intégralité Nouveau Testament en russe, des livres individuels de l'Ancien Testament ont ensuite été publiés et, en 1876, la Bible russe complète a été publiée.
Ainsi, le terrain pour une prédication généralisée de l’Évangile en Russie a été historiquement préparé. Parmi ceux qui y ont répondu, il y avait des gens qui recherchaient la vérité et qui ne pouvaient se contenter des croyances rituelles de l'Église officielle. Un chercheur du début du XXe siècle écrit sur les protestants russes. M. N. Pokrovsky : « On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas eu de Réforme en Russie. Cela est bien sûr vrai si l’on comprend la Réforme comme un mouvement populaire à l’échelle du XVIe siècle allemand. ou anglais XVIIe siècle. Mais cela n’empêche pas le fait que nous avons eu et avons encore des sectes protestantes – il y avait et il y a toujours le protestantisme populaire russe..."1
« Protestants du peuple russe » pendant longtemps ont été privés de la possibilité d’entendre la prédication de la Parole de Dieu dans son intégralité. Mais en quête de vérité, ils ont quitté l’Église officielle et ont créé de nombreux mouvements qui ont attiré des milliers de fidèles. N'ayant pas une Bible complète, étant pour la plupart des gens analphabètes, ces chercheurs de la vérité de Dieu se rapprochaient souvent de la compréhension des vérités bibliques qui existe aujourd'hui dans l'Église Adventiste. Par exemple, le mouvement Strigolnik au XIVe siècle. prêchait le salut par la foi et rejetait de nombreux rituels orthodoxes. Mouvement des judaïsants au XVe siècle. professaient l'observance du sabbat et niaient le culte des icônes2. Boyar Matthew Bashkin au 16ème siècle. opposé hiérarchie de l'église et le monachisme, critiquant l’Église officielle « pour avoir perdu l’Évangile ». Il a été repris par son serf libre-penseur contemporain Theodosius Kosoy, qui croyait que le christianisme ne réside pas dans l'observation de rituels, mais dans l'accomplissement des commandements de Jésus et dans l'amour de son prochain. Au 17ème siècle après la scission de l'Église orthodoxe russe, de nombreux mouvements protestants sont apparus, comme le peuple de Dieu, croyants chrétiens, chrétiens spirituels. Ils prêchaient tous une piété pratique, vivant conformément à l’Évangile. Au XVIIIe siècle. Le relais a été repris par les Doukhobors, qui prêchaient le renouveau spirituel, et les Molokans, qui se donnaient pour objectif de vivre selon la Bible.
À propos de leur popularité mouvements religieux, qui a rassemblé de nombreux adeptes, est attestée par la lutte acharnée de l'État contre la dissidence, qui a miné l'autorité de l'Église officielle. Des documents et des livres sur l'histoire des protestants russes, il s'ensuit que l'esprit du protestantisme n'était pas du tout étranger au peuple, de sorte que des milliers de personnes ont répondu à la prédication de l'Évangile au XIXe siècle. Pour de nombreux Russes assoiffés de vérité, l’opportunité s’est enfin ouverte d’entendre la vérité que le Seigneur a révélée aux protestants européens, à commencer par Wycliffe, Huss et Luther3.
Nouvelle vague de protestantisme en Russie
Le renouveau spirituel des protestants russes commence dans le sud de la Russie, où, dans les années 1840. Un mouvement appelé Stundisme surgit parmi les mennonites et les luthériens. Les Stundistes (de l'allemand : Die Stunde - heure) étaient connus pour se réunir régulièrement dans les maisons pour étudier les Saintes Écritures, chanter et prier. De telles réunions étaient appelées « heures de communion avec le Seigneur ». Le stundisme couvre rapidement les communautés protestantes d’Ukraine, du sud de la Russie et de Transcaucasie, pour se déplacer progressivement vers le centre de la Russie. Non seulement les immigrants protestants, mais aussi les Russes de souche viennent à la réunion. Le mouvement Shtunda a influencé de manière significative la propagation des baptistes et de l’adventisme dans notre pays.
Depuis 1867, des prédicateurs baptistes allemands parcourent le sud de la Russie. En 1871, le prédicateur baptiste Grenville Redstock fut invité à prononcer un discours dans les maisons de la haute société de Saint-Pétersbourg. Ses sermons font une telle impression que les adeptes du Baptistisme deviennent des personnes célèbres de l'époque parmi l'élite de la société : le colonel V. A. Pashkov (sa belle maison orne le centre de Moscou) ; le comte M. M. Korf ; Ministre des Chemins de fer, le comte A.P. Bobrinsky, les princesses V.F. Gagarina, N.F. Lieven, E.I. Chertkova et autres. Selon les données officielles, en 1917, il y avait environ 200 000 baptistes en Russie.4
Depuis 1886, le message des trois anges de l’Église adventiste du septième jour a commencé à retentir en Russie. De nombreux livres merveilleux ont été publiés sur l’histoire de notre Église5.
Patience protestante et tolérance orthodoxe
Pour compléter le tableau, il est nécessaire de dire quelques mots sur le protestantisme russe et le statut juridique des protestants. Lorsqu'on entend aujourd'hui des discours fiers selon lesquels « la Russie a toujours préservé de manière sacrée la foi orthodoxe », ces mots cachent la situation dramatique de la liberté de conscience dans l'Empire russe, qui existait au XIe siècle. il n'y en avait pratiquement pas. Derrière le slogan « autocratie, orthodoxie, nationalité », qui exprimait l'essence de la politique de l'époque en matière de relations entre religion et État, qu'on tente encore aujourd'hui de relancer, se cache le rejet absolu de toute foi autre que orthodoxe et souligne l'étrangeté du protestantisme.
Mais comment la position dominante de l’Église orthodoxe a-t-elle été obtenue ? D’abord parce qu’il a été élevé au rang d’État. L'État a soutenu l'Orthodoxie financièrement et législativement. L’Église orthodoxe a-t-elle acquis son autorité grâce à des activités évangéliques ? Non! Mais il est bien connu que les habitants de l’Empire russe ont été contraints à la foi orthodoxe par des mesures policières sévères et par de fortes pressions des autorités. Voici quelques exemples de la façon dont la foi paternelle a été « préservée ».
Selon le Code des lois de l'Empire russe, toutes les confessions étaient divisées en quatre niveaux, chacun ayant son propre éventail de droits, privilèges et restrictions6. Au premier niveau se trouvait l’Église orthodoxe russe. Les croyants orthodoxes jouissaient de tous les droits. Plus d'un millier d'articles du Code des lois protégeaient les droits de l'Église orthodoxe. La loi déclare l’Église orthodoxe russe « prééminente et dominante ». Cela signifiait que l'empereur de toute la Russie ne pouvait professer aucune autre foi que l'orthodoxe et devait défendre les intérêts de l'Église orthodoxe7. La loi a déclaré les fêtes orthodoxes comme jours fériés. Pas un seul événement ou célébration d’État le plus important ne pourrait avoir lieu sans les hiérarques de l’Église.
Dans la deuxième étape, il y avait les confessions « reconnues tolérantes », qui comprenaient : les catholiques, les protestants, les églises arméno-grégoriennes et arméno-catholiques, les sectes chrétiennes (mennonites, baptistes, adventistes), ainsi que les confessions non chrétiennes : juifs, musulmans, Bouddhistes, Lamaïstes (religion païenne). Les croyants de ces confessions avaient beaucoup moins de droits. Par exemple, ils ne pouvaient pas occuper certains postes gouvernementaux et la Zone de colonisation fut introduite pour les Juifs ; leur droit d'étudier dans les gymnases et les établissements d'enseignement supérieur était limité. les établissements d'enseignement. Et tout cela - pour des «raisons d'État».
À un niveau encore plus bas se trouvaient les « tolérants non reconnus ». C'étaient des schismatiques et des sectaires qui se séparèrent en temps différent de l'Église orthodoxe russe. L’abandon de l’orthodoxie étant considéré comme un crime d’État, il était interdit à ces personnes de pratiquer tout type d’activité religieuse. La violation de cette interdiction était passible de poursuites pénales.
Et enfin, il y avait la catégorie la plus basse de croyants – « méconnus et intolérants ». La loi incluait les soi-disant sectes fanatiques (par exemple, les eunuques), ainsi que les confessions qui, en fonction de circonstances historiques spécifiques, étaient classées par l'État comme hostiles. L'appartenance à ces religions était elle-même punie par la loi.
La loi religieuse a été utilisée pour mettre en œuvre Politique nationaleÉtats. Chaque religion était attribuée par la loi à une nation spécifique. Les Tatars devaient professer l'islam, les Juifs - le judaïsme, les Polonais - le catholicisme, les peuples d'Europe occidentale - le protestantisme, les Bouriates - le bouddhisme, etc. La prédication de toute croyance en dehors des frontières de la communauté nationale « inhérente » ou du territoire canonique était interdite. Seule l'Église orthodoxe, selon l'art. 97 du Code des lois, a reçu le droit à l'activité missionnaire parmi tout peuple et sur tout territoire8. La raison en était la tâche de l’État consistant à russifier la périphérie de l’empire et à établir le statut privilégié du peuple russe parmi les autres peuples de Russie. C’est alors que fut établie la formule sacramentelle : russe signifie orthodoxe.
Est-il possible de dire au cœur comment croire ?
Le Code pénal et la Charte pour la prévention et la répression des délits contenaient environ 40 articles dirigés contre les « séducteurs », c'est-à-dire ceux qui se livraient à une activité missionnaire. Ainsi, par exemple, un missionnaire qui prêchait aux orthodoxes fut privé de tous les droits sur sa fortune et exilé en Sibérie ou dans le Caucase. Par exemple, le prédicateur adventiste Feofil Babienko a été soumis à une telle punition. Il était interdit de prêcher même à vos propres femmes ou maris, même aux enfants (si au moins l'un des parents avait été baptisé dans la foi orthodoxe) et aux serviteurs. Non seulement les « séducteurs » ont été persécutés, mais aussi ceux qui n'ont pas interféré avec leurs intentions. Ainsi, dans l'art. 192 dit : « Quiconque, sachant que sa femme ou ses enfants, ou d'autres personnes pour lesquelles la surveillance et les soins lui sont accordés par la loi, ont l'intention de s'écarter de la religion orthodoxe, n'essaiera pas de les dévier de cette intention et n'acceptera pas. quoi que ce soit qui dépend de lui par des mesures légales pour empêcher l'exécution d'Onago, il est condamné pour ceci : à une arrestation de trois jours à trois mois et de plus, s'il est orthodoxe, il est transféré à la repentance de l'Église »9. Les soi-disant témoins extérieurs étaient également tenus de signaler aux autorités les opinions religieuses d’une personne. Art. 56 a ordonné au « peuple russe » né et élevé dans la foi orthodoxe, vivant avec les nouveaux baptisés dans les mêmes villages, d’« observer les actions des nouveaux baptisés ».
Le droit de se convertir au protestantisme n'était accordé qu'aux personnes appartenant à une église de la même catégorie juridique que les protestants, ou « moins tolérantes », et uniquement avec l'autorisation des autorités civiles. Ainsi, par exemple, un juif, un mahométan (musulman) ou un bouddhiste pourrait devenir protestant. La loi réglementait également à partir de quelles confessions non chrétiennes et vers quelles confessions chrétiennes et dans quelles conditions les conversions pouvaient avoir lieu.
Le mariage d'un chrétien orthodoxe et d'un protestant ne peut être conclu que dans les conditions précisées par la loi de l'État. Par exemple, la cérémonie de mariage ne pouvait être célébrée que par Prêtre orthodoxe et seulement dans l'Église orthodoxe. Au moment du mariage, les mariés ont signé au prêtre une signature indiquant que le conjoint non orthodoxe ne persuaderait pas le conjoint orthodoxe de renoncer à sa foi, en d'autres termes, il était interdit de prêcher à son conjoint10.
Les enfants nés d'un mariage mixte devaient être élevés uniquement selon les règles Foi orthodoxe. Même en cas de décès d'un conjoint orthodoxe, le conjoint non orthodoxe devait toujours respecter cette règle. Les enfants dont la religion des parents était inconnue devaient être baptisés selon le rite orthodoxe et étaient considérés comme orthodoxes, même s'ils étaient élevés par des personnes d'une religion différente.
La législation russe ne reconnaît pas la liberté de religion, car elle considère la foi comme faisant partie de la politique nationale, qui est exclusivement une prérogative de l'État. En Russie, le droit individuel à l’autodétermination religieuse n’était pas reconnu ; la religion était utilisée pour résoudre des problèmes purement politiques. L’État s’est immiscé dans les activités ecclésiales internes des confessions sur leurs territoires canoniques, tout en soutenant uniquement l’Église orthodoxe11.
Quand les protestants de Russie deviendront-ils les leurs ?
Sur la base de ce qui précède, on ne peut qu’admirer la soif de vérité qu’ont nourrie des milliers de Russes lorsqu’ils se sont convertis au protestantisme à cette époque. Malgré les restrictions, à la fin du XIXe siècle. La Russie est en train de devenir un pays multiconfessionnel. Les sujets de l'empereur russe professent le catholicisme, le protestantisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme et bien d'autres religions. Fin du 19ème siècle. le nombre de chrétiens orthodoxes dans l’Empire russe représentait un peu plus de la moitié de la population totale de la Russie (72 sur 125 millions)12.
On est surpris de découvrir le nombre élevé de protestants au début du 20ème siècle. atteint 3 millions (pour 125 millions d’habitants)13.
Un chiffre trois fois supérieur au nombre de protestants en la Russie moderne! Et c’étaient les personnes les plus avancées et les plus actives de leur époque, qui ont apporté une contribution sérieuse au développement de l’économie, de la culture et de la science du pays.
Face à des faits aussi convaincants, il est difficile de discuter avec le célèbre chercheur russe de l'histoire du protestantisme N.A. Trofimchuk, qui a écrit : « Jetant un coup d'œil dans les profondeurs histoire russe et sachant que les églises et associations protestantes occupent désormais la deuxième place en nombre de communautés et la troisième place en nombre d'adhérents dans le tableau confessionnel multicolore de notre pays, il faut reconnaître que, même si le protestantisme en Russie est sans aucun doute un phénomène plus jeune que l'Orthodoxie ou l'Islam, et principalement apportés de l'Occident, et que sa contribution à la construction de la culture et de l'État russes, bien sûr, est sans commune mesure avec la contribution et rôle historique Mais l’orthodoxie (éd.), cette tendance existe en Russie depuis au moins 400 à 450 ans, et ce serait une erreur de la placer en dehors de la culture et de la tradition russes »14.
Nous, protestants russes, pouvons à juste titre être fiers de notre histoire vieille de plusieurs siècles. Le fait que la culture russe soit cultivée exclusivement sur le levain de l’Orthodoxie n’est qu’un mythe, bénéfique aux pseudo-patriotes qui tentent de gravir l’Olympe du pouvoir politique dans le sillage de la renaissance économique, politique et spirituelle du pays. La Russie a toujours été et restera un pays multiconfessionnel dans lequel les protestants ne sont pas des invités, mais des citoyens à part entière qui ont apporté et continuent d'apporter une contribution significative à la construction de la société civile et à l'établissement des idéaux évangéliques de bonté et de justice dans le pays. il. Ce n'est qu'en nous sentant partie intégrante du peuple russe, en partageant avec lui ses besoins et ses préoccupations, que nous pourrons accomplir la mission que Jésus-Christ nous a confiée.
1 Pokrovsky M. N. Essai sur la culture russe. Koursk, 1924. P. 237.
2 Zaitsev E.V. Histoire des observants du sabbat en Russie. "Image et ressemblance". Publication de l'Académie théologique Zaokskaya, 1993, n° 2. pp. 44-51.
3 Vous pouvez lire en détail ces mouvements dans l’article de M. S. Katernikova « La recherche de Dieu russe ».
4 Mitrokhin L.N. Baptistisme : histoire et modernité. P. 250.
5 Par exemple : Yunak D. O., « History of the Church of Seventh-day Adventist Christians », 2 volumes, publié par l'Union de Russie occidentale de l'Église des chrétiens adventistes du septième jour ; conférences sur l'histoire de l'Église Adventiste par E. V. Zaitseva, Académie théologique Zaokskaya ; Teppone V.V. « De l'histoire de l'Église », Kaliningrad, 1993 ; « De l'histoire de l'Église des chrétiens adventistes du septième jour », Académie théologique Zaokskaya, 2001, n° 2.
6 Code des lois de l'Empire russe. T. 1. Art. 40, 44, 45. Saint-Pétersbourg, 1897.
7 Suvorov N. Manuel de droit de l'Église. M., 1912. P. 515-523.
8 Code des lois de l'Empire russe. T. 14. Art. 97, Saint-Pétersbourg, 1897.
9 Code des lois de l'Empire russe. T. 14. Art. 47. Saint-Pétersbourg, 1897.
10 Klochkov V.V. Religion, État, droit. p. 89, 104.
11 Pinkevich V.K. Système religieux de l'Empire russe. État, religion, église en Russie et à l'étranger. Bulletin d'information et d'analyse. M., maison d'édition RAGS, 2001, n° 4.
12 Smolich I.K. Histoire de l'Église russe. T. 1. M., 1996. P. 28.
13 Trofimchuk N. A. Histoire des religions en Russie. M., maison d'édition RAGS, 2001. P. 582.
14 Trofimchuk N. A. Histoire des religions en Russie. M., maison d'édition RAGS, 2001. P. 305.
Les différences dans le protestantisme moderne ne sont pas tant des différences entre les différentes directions, églises et confessions en termes de doctrine et de structure, mais plutôt des différences entre les tendances au sein du protestantisme lui-même. Depuis le milieu du XXe siècle, les grands mouvements du protestantisme dans notre pays, comme dans le monde entier, ont été fortement influencés environnement externe, un monde de plus en plus laïc. Il y a de moins en moins de personnes qui assistent régulièrement aux cultes. Dans le même temps, des cercles d'étude intensive de la Bible et de compréhension de celle-ci par rapport à l'époque apparaissent ; la foi n'est pas seulement héritée de la génération passée, mais elle est acquise de manière indépendante.
Toutes ces remarques s'appliquent entièrement aux églises protestantes de ce pays, ou aux « sectes », comme on les appelait récemment.
Les mouvements sectaires, « réforme » au sens large, apparaissent en Russie vers le XIVe siècle. Ses principales formes étaient le Skoptchestvo, la Croyance Chrétienne, le Doukhoborisme, le Sabbatarisme, généralement représentés par divers groupes. Tous ont résolument rejeté l'Église orthodoxe, la piété extérieure en faveur de la foi intérieure (« Dieu n'est pas dans les bûches, mais dans les côtes ») et ont cherché à créer des communautés autonomes comme prototypes du « royaume de Dieu ».
La première association protestante en Russie fut la secte des mennonites ou « anabaptistes pacifiques », née en Hollande au XVIe siècle. Leur prédication se distinguait par les idées d'humilité et de soumission, de renoncement à la violence et à la guerre, qui furent ensuite clairement ancrées dans l'exigence religieuse de renoncer au service militaire et à l'usage des armes. Cela leur a valu de graves persécutions de la part des autorités. Après que Catherine II ait autorisé les étrangers à s'installer en Russie (1763), les mennonites d'Allemagne ont commencé à s'installer dans le sud de l'Ukraine et dans la région de la Volga. Leur apparition en Russie n'a pas eu beaucoup d'impact sur la situation religieuse de l'époque.
La propagation généralisée du protestantisme dans notre pays a commencé dans les années 60 et 70 du XIXe siècle avec l'émergence d'adeptes des baptistes évangéliques d'Allemagne. Ils menèrent un travail de prédication actif et commencèrent à fonder des communautés dans les régions du Caucase, du sud de l'Ukraine, des États baltes et de Saint-Pétersbourg. Le premier baptiste russe fut le marchand N. Voronine, baptisé avec foi à Tiflis en 1867. L'augmentation du nombre de chrétiens évangéliques, de baptistes et d'adeptes d'autres mouvements protestants a provoqué une réaction extrêmement négative de la part des dirigeants de l'Église orthodoxe russe. Bientôt, la persécution et la répression commencèrent.
Dans la résolution de la réunion des dirigeants orthodoxes sous la direction de K.P. Pobedonostsev, qui était à l'époque procureur en chef du Saint-Synode, a notamment déclaré : "La croissance rapide du sectarisme constitue un grave danger pour l'État. Il faut interdire à tous les sectaires de quitter leur lieu de résidence. Tous les crimes contre l'Église orthodoxe doivent être traités non pas par des tribunaux laïcs, mais par des tribunaux spirituels. Les passeports des sectaires doivent être marqués d'une manière spéciale afin qu'ils ne soient acceptés pour travailler ou résider nulle part jusqu'à ce que la vie en Russie leur devienne insupportable. Leurs enfants doivent être enlevés. de force et élevé dans la foi orthodoxe. »
Ce n'est qu'en 1905, avec la publication du décret sur la tolérance religieuse du 17 avril et du Manifeste sur l'octroi des libertés civiles du 17 octobre, que les églises protestantes furent en mesure de mener des activités missionnaires et éditoriales.
Le plus grand mouvement protestant en Russie est le baptiste. Le nom vient du grec « immerger », « baptiser dans l’eau ». Le nom actuel de l'église est formé à partir des noms de deux mouvements apparentés : les baptistes, qui portaient initialement le nom de « chrétiens baptisés par la foi » et vivaient principalement dans le sud de l'État russe, et l'église des « chrétiens évangéliques », qui est apparue un peu plus tard, principalement dans le nord du pays.
L'unification des Églises de confession évangélique a été réalisée sur la base de l'Accord des chrétiens évangéliques et baptistes de 1944. En 1945, un accord fut conclu avec les représentants des églises pentecôtistes, appelé « Accord d'août », en 1947, un accord fut conclu avec les chrétiens dans l'esprit des apôtres, et en 1963 les mennonites furent acceptés dans l'union.
Les pentecôtistes fondent leur doctrine sur les instructions de l'Évangile concernant la « descente du Saint-Esprit sur les apôtres » le cinquantième jour après Pâques. Les mennonites considèrent l'humilité, le renoncement à la violence, même si elle est engagée pour le bien commun, et l'amélioration morale comme les caractéristiques les plus essentielles du christianisme.
L'Union des baptistes chrétiens évangéliques fait partie de l'Union baptiste mondiale depuis sa fondation en 1905 et partage les sept principes bibliques - les fondements théologiques développés par la Fraternité universelle : " Sainte Bible, les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament (canoniques) constituent la base de la Doctrine. L'Église devrait être composée exclusivement de personnes régénérées. Les commandements concernant le baptême et la Cène du Seigneur (communion) appartiennent également aux personnes régénérées. Indépendance de chacun église locale. Égalité de tous les membres de l'église locale. Liberté de conscience pour chacun. Séparation de l'Église et de l'État.
L'Union des baptistes chrétiens évangéliques - tant en général que dans chaque église locale - considère que ses tâches sont la prédication de l'Évangile, l'éducation spirituelle des croyants pour atteindre la sainteté, la piété chrétienne et l'observance des commandements du Christ dans la vie, le développement et le renforcement de l'unité des croyants conformément à la prière sacerdotale du Christ, la participation active au service social.
Aujourd'hui, l'Union des baptistes chrétiens évangéliques de Russie publie deux magazines, « Brotherly Messenger » et « Christian and Time », plus d'une douzaine de journaux, publie des Bibles, des recueils de chants spirituels et d'autres publications chrétiennes.
Une autre église protestante courante dans la Russie moderne est l’Église adventiste du septième jour. La fondatrice de ce mouvement est considérée comme la prophétesse américaine Ellen White, qui, guidée par ses « visions » dans lesquelles « le Seigneur lui révélait des vérités », a développé les idées de l'Adventisme. L'essentiel était l'instruction de célébrer non seulement le dimanche, mais aussi le samedi, tous les jours de la semaine, lorsqu'il est impossible non seulement de travailler, mais même de cuisiner. Ainsi, l’accomplissement du quatrième commandement biblique a été mis au premier plan : « Souvenez-vous du jour du sabbat pour le sanctifier : six jours vous travaillerez et ferez tout votre ouvrage, mais le septième jour est le sabbat du Seigneur votre Dieu : le si vous ne faites aucun ouvrage… » (Ex. 20 : 8-10).
Les adventistes du septième jour ont développé des dogmes, des rituels et un mode de vie dans lesquels la « réforme sanitaire » joue un rôle particulier. Sa justification théologique réside dans l'affirmation que le corps est le temple du Saint-Esprit et que, pour ne pas le détruire, il faut mener une vie appropriée. Ils ont des interdictions alimentaires, ainsi que l'interdiction de boire du thé, du café, des boissons alcoolisées et de fumer.
Aujourd’hui, il y a plus de 30 000 adventistes du septième jour dans notre pays et ils disposent d’environ 450 lieux de culte. Le corps central de cette église est situé dans la région de Toula, dans le village de Zaoksky, où sont gérés une école théologique et un séminaire ainsi qu'un centre de radio et de télévision. L'Église publie des journaux et un certain nombre de magazines conjointement avec des adventistes étrangers. Les membres de l’Église aident les jardins d’enfants, les hôpitaux et les personnes âgées. Un centre de réadaptation a été créé dans la région de Toula sous la direction de Valentin Dikul, où sont aidés les enfants malades.
Parmi les autres mouvements protestants opérant dans la Russie moderne, il faut citer les chrétiens de foi évangélique ou pentecôtistes. Le nom remonte au récit évangélique selon lequel lors de la célébration de la fête de la Pentecôte (50e jour après Pâques), le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et ils « furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues » ( Actes 2:4). Les croyants de cette dénomination pratiquent le « parler en d’autres langues » lors des réunions de prière, croyant en la possibilité que le Saint-Esprit habite les vrais croyants. En Russie, cette église compte plusieurs mouvements.
En 1992, une organisation religieuse et sociale appelée « Armée du Salut » a commencé à opérer activement dans notre pays. Le mouvement est né en Angleterre au siècle dernier et a une organisation stricte : les soldats de l'Armée du Salut prêtent serment d'allégeance à Dieu, servent le peuple et Dieu, s'abstiennent de l'alcool, du tabac, de la toxicomanie et d'autres mauvaises habitudes. Ils sont engagés dans l'évangélisation et travail social. À Moscou, l’Armée du Salut a ouvert 18 cantines gratuites, vient en aide aux réfugiés et aux sans-abri et fournit une aide humanitaire aux hôpitaux, aux jardins d’enfants et à d’autres personnes dans le besoin.
Il y a actuellement en Russie plus d’un million de croyants protestants appartenant à des dizaines de confessions protestantes différentes. Certains d’entre eux sont apparus au siècle dernier, d’autres sont apparus ces dernières années. Le développement des relations marchandes et les changements dans l'idéologie de l'État contribuent au renforcement de la position du protestantisme. Avec le soutien de leurs centres internationaux étrangers, ils mènent un travail missionnaire actif pour évangéliser la population, distribuent une énorme quantité de littérature religieuse et d'autres produits.
CDU 274 (=161,1) : 008 (=161,1)
A. V. Soukhovsky
Protestantisme russe et culture russe
L’article analyse le phénomène du protestantisme russe et tente d’en identifier les traits essentiels et typologiques. Un bref aperçu de l'histoire du stundisme et du pachkovisme est donné. La question de la place et du rôle du protestantisme dans la culture russe et les perspectives de développement de ce courant religieux sont examinées.
Cet article analyse le phénomène du protestantisme russe, l'auteur tentant d'en dégager les caractéristiques essentielles et typologiques, en présentant un bref aperçu de l'histoire du stundisme et du pachkovisme et en s'attardant sur la place, le rôle et les perspectives du protestantisme dans la culture russe.
Mots clés: protestantisme, christianisme évangélique, pachkovites, redstockisme, stundisme, culture, religion.
Mots clés : protestantisme, chrétiens évangéliques, pachkovisme, radstockisme, stundisme, culture, religion.
Lorsque l’on rencontre l’expression « protestantisme et culture russe », des questions surgissent immédiatement. La conjonction « et » est-elle même appropriée ? Y a-t-il des points communs ? Quelle est la place du protestantisme dans la culture russe ? Quel est son rôle dans la formation de la Russie ?
Ces questions ne sont pas aléatoires. Ils indiquent que la mémoire historique dans ce domaine s’est amenuisée. De combien de noms de personnalités publiques et d’artistes professant le protestantisme les gens modernes se souviendront-ils ? Après période soviétique, alors qu’il n’était pas d’usage de mentionner l’appartenance religieuse, la liste des noms ne risque pas d’être longue.
Parallèlement, le protestantisme a joué un rôle important dans le développement de la culture russe. Au moins dans l’ouest de la Russie, l’influence du protestantisme est clairement perceptible. Le protestantisme a commencé à pénétrer en Russie au XVIe siècle et, à partir du règne de Pierre Ier, il est devenu partie intégrante de l'histoire russe.
Un nombre important de spécialistes ayant avoué appartenir au protestantisme travaillaient en Russie. Ils ont apporté de nombreuses réalisations de la culture occidentale sur les terres russes (bien sûr, pas toujours directement liées au protestantisme).
© Soukhovsky A.V., 2015
La mission culturelle des protestants en Russie ne se limitait pas à la simple « importation » des traditions occidentales. Les protestants n'ont pas apporté moins de contribution à la région science russe, l'art, pour renforcer le pays, devenu pour eux la Patrie. Des exemples frappants ici peuvent être les figures des luthériens - V.I. Béring, M.B. Barclay de Tolly, I.F. Krusenstern, G.V. Steller, V.I. Dalia, A.P. Bryullova, K.P. Bryullova, D.I. Grimm ; Réformé - K. Cruys, D. Bernoulli, G. Wilhelm de Gennin et bien d'autres.
Pendant longtemps, les protestants n’étaient autorisés qu’à professer leur foi, mais pas à la prêcher. C’était « une bougie sous le boisseau ». Seule une personne qui n'était pas d'origine russe pouvait être protestante en Russie. L'analogue religieux du servage n'a pas permis à la population russe de quitter l'orthodoxie.
Cependant, malgré les interdictions, les idées religieuses du protestantisme ont pénétré à la fois parmi le peuple et dans les salons de la haute société. Un exemple d’une telle interaction interculturelle est le stundisme et le pachkovisme1.
Le stundisme est apparu dans le sud de la Russie au XIXe siècle. La condition préalable à sa formation était la « colonisation » protestante de ce territoire. Après la guerre russo-turque de 1768-1774. La Russie a reçu en guise d'indemnité la côte nord de la mer Noire. Pour peupler ces terres, le gouvernement de Catherine II décide d'inviter des Allemands, des Mennonites et des Réformés, connus pour leur haute culture agricole. Le premier groupe de colons, au nombre de 228 familles, est apparu ici en 1789. En général, la réinstallation des colons sur ce territoire s'est poursuivie jusqu'en 1861.
La seule condition posée aux colons allemands était l’interdiction du prosélytisme parmi les orthodoxes. En effet, l’activité religieuse des croyants allemands se limitait initialement à leur propre cercle. Mais en 1845, le pasteur luthérien piétiste Eduard Wüst arriva en Russie en provenance d'Allemagne à l'invitation des mennonites. Il a pris la place de pasteur dans la colonie de Neugof-nung, dans le district de Berdiansk. Wüst était un prédicateur fougueux et il réussit bientôt à contaminer d'autres mennonites et luthériens avec son enthousiasme. Des « cercles Wüst » commencent à apparaître dans toutes les colonies.
1 Dans cet article, nous ne considérerons pas les mouvements religieux des Molokans et des Doukhobors, puisqu’ils ne peuvent, au mieux, être considérés que comme les précurseurs des protestants russes.
Les croyants allemands ont commencé à inviter les paysans russes et ukrainiens qui travaillaient pour eux pendant l'été à étudier la Bible. Dans la tradition piétiste, ce type de lecture de la Bible à la maison avec la famille et les amis proches était appelé « l’heure biblique ». C'est ainsi qu'est né le nom du mouvement russo-ukrainien - Stundism (heure allemande - Stunde).
Revenus de leurs travaux d'été dans leurs villages, les paysans y organisaient des cercles bibliques, à l'instar des cercles allemands. Ce phénomène a donc touché une partie importante de la Russie. Gerhard Wieler, Johann Wieler et Abraham Unger ont joué un rôle important dans le développement du stundisme. Unger a baptisé Efim Tsymbal. Par la suite, Tsymbal a baptisé Ivan Ryaboshapka, et lui-même a baptisé Mikhaïl Ratushny et Ivan Kapustyan. Tsymbal, Ryaboshapka et Ratushny sont devenus des figures marquantes du mouvement évangélique du sud de l'Ukraine.
Il est important de noter que le stundisme ukraino-russe n’était pas une simple répétition de sa variante allemande du piétisme. Les croyants allemands, lorsqu’ils formaient des groupes d’étude biblique, ne quittaient pas le cadre de leurs dénominations (luthéranisme et mennonitéisme). Les stundistes russes et ukrainiens se sont très vite éloignés de l’orthodoxie, sans devenir luthériens ou mennonites. Prenant la forme du piétisme allemand, ils l'ont rempli de nouveau contenu. Le stundisme ukraino-russe est devenu un mouvement indépendant avec son propre credo et sa propre approche du culte.
Cette approche était essentiellement protestante. C'est ce qui est dit dans les « Informations sur l'état des schismes dans la province de Kherson » : « ... Lors d'une visite au village de Karlovka, district d'Elisavetinsky, à la fin du mois de mai, ce responsable s'est convaincu que les stundistes locaux font positivement ne va pas à l'église, ne baptise pas les enfants, ne va pas à la confession et ne communie pas avec saint. Secrets, ils enterrent eux-mêmes les morts et ne mettent pas de croix sur leurs tombes : parmi les fêtes, seules celles établies en souvenir des événements mentionnés dans le Nouveau Testament sont honorées ; lire constamment Saintes Écritures, ils l'ont étudié avec beaucoup d'acharnement ; St. ils ne reconnaissent pas la tradition et les autorités de l’Église orthodoxe en général ; dans leur culte ils s’efforcent d’atteindre la simplicité des premiers temps du christianisme. » .
On peut noter que le rejet de l’orthodoxie prend ici les formes les plus radicales, proches du non-conformisme religieux. Cela ressemblait à un rejet de formes institutionnelles claires de religion. Mais il est évident qu’une partie du peuple russe était proche d’un tel non-institutionnalisme religieux.
La perte de l’autorité morale de l’Église orthodoxe aux yeux de la paysannerie a également joué un certain rôle. Prenez, par exemple, de nombreux proverbes russes consacrés au caractère moral des ministres de l'Église : « la soutane demande de la viande », « tout va à l'âne et au voleur », etc.
Le stundisme a proposé l'orthopraxie au lieu de l'orthodoxie. Et même les critiques l’ont généralement reconnu. Voici un témoignage tiré des « Notes d'un voyageur sur le stundisme dans le district de Tarashan » : « Le succès du stundisme a été grandement facilité par le fait que dès le début, il a mis sur sa bannière l'exigence d'une vie professionnelle stricte, honnête et sobre. . Le nouvel enseignement, avec tout son attachement extérieur à la parole de Dieu, a semblé dès la première fois à certains gens être d'autant plus élevé que l'orthodoxie que le vrai christianisme, c'est-à-dire l'orthodoxie elle-même, est supérieur au paganisme.
Indépendamment du stundisme, dans le nord de la Russie, à Saint-Pétersbourg, est né un autre mouvement de protestants russes : le pachkovisme.1 La condition préalable à l'apparition de ce mouvement dans la capitale était l'arrivée du seigneur anglais Grenville Valdigrev Redstock. Sa première visite en Russie eut lieu en avril 1874. Redstock vint à Saint-Pétersbourg à l'invitation de la princesse Elizaveta Chertkova, qui le rencontra en Suisse. La maison de Chertkova est devenue un lieu de réunions, de conversations spirituelles et de sermons de Redstock. Il convient de noter qu'au moment où Lord Redstock est arrivé à Saint-Pétersbourg, il avait déjà des partisans ici. La princesse Lieven et les sœurs Kozlyaninov, à l'étranger, assistèrent aux réunions d'évangélisation de Redstock et devinrent ses partisans.
Les activités de Redstock ont trouvé un vif écho en Russie. La réaction a varié - de l'acceptation totale au rejet décisif, mais personne n'est resté indifférent. Leskov écrit que Redstock «… a fait beaucoup de bruit en Russie. Malgré le fait que l'activité de cet homme était pour ainsi dire éphémère et jusqu'à présent limitée à un très petit cercle de la haute société, il n'y a désormais pratiquement aucun coin aussi isolé en Russie où ils n'auraient entendu et en même temps on parlait parfois de Lord Redstock. Même les gens qui ne pouvaient pas prononcer son nom parlaient de lui et au lieu de Redstock, ils l'appelaient « la croix », liant les activités de baptême à ce nom.
1 Plus tard, les adeptes de ce mouvement ont choisi le terme « Chrétiens évangéliques » comme nom propre.
Les opinions de Redstock étaient proches du darbyisme (les enseignements de John Nelson Darby). Les Darbistes, ou frères de Plymouth, adhéraient aux principes fondamentaux du protestantisme, mais ne disposaient pas de bâtiments spéciaux pour le culte et se réunissaient dans des appartements et des maisons privés. Ils ne reconnaissaient pas la nécessité de l'ordination sacerdotale et mettaient l'accent sur l'égalité de tous les croyants. Par conséquent structure organisationnelle dans leurs communautés a été réduite au minimum. En Russie, Redstock a décidé de ne pas aborder le sujet des conflits religieux. Lorsqu'on lui a demandé à quelle église il appartenait, Redstock a répondu qu'il appartenait à l'Église chrétienne universelle. Il n’a pas non plus appelé ses partisans parmi les nobles à rompre avec l’orthodoxie. Le thème de ses sermons n'était que le retour à Dieu et le renouveau de la vie spirituelle.
Redstock ne s'est rendu en Russie que trois fois. En 1878, il fut expulsé du pays. Cependant, pendant le temps que Redstock a passé en Russie, il a réussi à gagner de nombreux partisans. Il s’agissait principalement de personnes issues de la haute société. Parmi eux : maître de cérémonie de la cour royale M.M. Korf, le comte A.P. Bobrinsky, la princesse Chertkova mentionnée, la comtesse Shuvalova. Un rôle clé dans l'histoire du christianisme évangélique a été joué par le colonel Vasily Alexandrovich Pashkov, un ami proche d'Alexandre II. Ce n’est pas pour rien que les critiques ont commencé à utiliser son nom de famille pour désigner ce mouvement religieux.
Puisque Redstock prêchait en français, son public était principalement composé de gens de la haute société (même si le sermon était traduit). Pashkov a commencé à prêcher en russe et le cercle des auditeurs s'est immédiatement élargi. Des représentants de diverses classes et professions venaient maintenant aux réunions. Les réunions étaient accompagnées de chants d'hymnes. Dans un petit chœur, ils ont chanté : Alexandra Ivanovna Peyker, les filles de Pashkov, les filles du ministre de la Justice, le comte Palen, deux princesses Golitsyne. La communauté a continué de croître, gagnant de nouveaux adeptes et de nombreux sympathisants.
Procureur général du Saint-Synode K.P. Pobedonostsev a écrit : « Ne connaissant ni leur Église ni leur peuple, ces gens, infectés par l'esprit du sectarisme le plus étroit, pensent à prêcher la Parole de Dieu au peuple... ». Il a été repris dans le « Journal d'un écrivain » de F.M. Dostoïevski : « Le véritable succès de Lord Redstock repose uniquement sur « notre isolement », sur notre isolement du sol, de la nation.<...>Voilà, je le répète, notre déplorable isolement, notre ignorance du peuple, notre rupture avec la nationalité, et en
à la tête de tout se trouve une conception faible et insignifiante de l’orthodoxie. Ailleurs dans son « Journal… » Dostoïevski dirigeait ses sarcasmes contre la shtunda populaire : « À propos, qu’est-ce que cette malheureuse shtunda ? Plusieurs ouvriers russes parmi les colons allemands se rendirent compte que les Allemands vivaient plus riches que les Russes et que cela était dû au fait que leur ordre était différent. Les pasteurs qui se trouvaient ici ont expliqué que ces ordres sont meilleurs parce que la foi est différente. Alors des groupes de Russes noirs se sont unis, ont commencé à écouter comment l’Évangile était interprété et ont commencé à lire et à interpréter eux-mêmes. .
Selon Dostoïevski et Pobedonostsev, si l'aristocratie était plus proche du peuple, aucun « apôtre » ne la dérangerait. Mais il est évident qu’il y avait également une confusion parmi la population. Le départ de l’orthodoxie vers le protestantisme est venu à la fois d’en haut et d’en bas. Dans une de ses lettres à Alexandre III, Pobedonostsev se plaint : « Les Pachkovites s'unissent en différents endroits avec les stundistes, les baptistes et les Molokans. »
La nouvelle foi a véritablement brisé les frontières de classe. Voici une description d'une réunion d'évangélisation typique de ces années-là : « Devant se tient un vieil Anglais<...>, et une jeune femme se tient à côté de lui et traduit en russe. Devant eux, sur des chaises, est assis un public très diversifié : voici une princesse, et à côté d'elle un cocher, puis une comtesse, un concierge, un étudiant, un domestique, un ouvrier d'usine, un baron, un fabricant, et tout est mélangé. Un exemple frappant de la manière de surmonter la désunion de classe est la conférence chrétienne tenue à Saint-Pétersbourg en 1884. C'est ainsi que le ministre évangélique I.S. la décrit. Prokhanov : « Ceux qui ont participé à la conférence s'en souviennent avec beaucoup d'enthousiasme. Les aristocrates de Russie, les simples paysans et les ouvriers s'embrassaient comme des frères et sœurs dans le Christ. L'amour de Dieu a surmonté toutes les barrières sociales. »
Les adeptes de Redstock sont devenus des participants actifs au service social. Ainsi, E.I. Chertkova est devenue membre du Comité des dames des visiteurs de prison. Avec sa sœur
A.I. Pashkova, ils ont organisé des ateliers de couture et des blanchisseries pour les femmes pauvres. A rejoint ce ministère
V. F. Gagarine. Pashkov a ouvert une cantine pour les étudiants et les travailleurs pauvres du côté de Vyborg à Saint-Pétersbourg. Yu.D. Zasetskaya (fille de Denis Davydov) a organisé le premier refuge de nuit à Saint-Pétersbourg et l'a géré elle-même. En 1875, M.G. Peyker et sa fille A.I. Peyker a jeté les bases de la publication de la revue religieuse et morale « Russian Worker ». Ce magazine a été publié jusqu'en 1885.
En 1876, Pashkov et d'autres croyants organisèrent la Société de lecture spirituelle et morale. Son activité consistait à publier de la littérature à contenu spirituel et moral en russe. Les livres de D. Bunyan « Le progrès du pèlerin » et « Guerre spirituelle » ont été traduits (traduit par Yu.D. Zasetskaya). Les sermons de Charles Spurgeon furent publiés, ainsi que des ouvrages orthodoxes : le métropolite Michel, St. Tikhon de Voronej et autres. Cette société a existé jusqu'en 1884.
Malgré le rejet des enseignements de Lord Redstock, même F.M. Dostoïevski fut forcé d’admettre : « Et pourtant, il fait des miracles dans le cœur des gens ; ils s'accrochent à lui ; beaucoup sont étonnés : ils recherchent les pauvres pour leur faire du bien rapidement, et veulent presque céder leurs biens<...>il produit des conversions extraordinaires et suscite des sentiments généreux dans le cœur de ses disciples. Cependant, il devrait en être ainsi : s’il est vraiment sincère et prêche une foi nouvelle, alors, bien sûr, il possède tout l’esprit et la ferveur du fondateur de la secte.
Les Pashkovites faisaient preuve à la fois d’orthopraxie et de religiosité extra-institutionnelle, même sous une forme plus prononcée que les stundistes. Bien entendu, le milieu aristocratique lui-même a marqué ce mouvement de son empreinte. Les Pachkovites se caractérisaient par une ouverture œcuménique. Et en cela ils étaient très différents des Stundistes. Si ces derniers se séparaient strictement de l'Église orthodoxe, alors les Pashkovites ne cherchaient pas du tout à rompre. Il y a là plutôt une tentative de synthèse, une recherche d'un universel chrétien. En général, l'accent parmi les Pashkovites (puis dans la communauté de I.V. Kargel) était davantage mis sur développement spirituel que sur les formes organisationnelles.
Tout cela caractérise le mouvement à ses débuts. Plus tard, en partie à cause des persécutions de l'État et de l'Église orthodoxe, en partie pour des raisons internes, le protestantisme russe a perdu bon nombre des caractéristiques originales du pachkovisme. Les Pashkovites, comme les Stundistes, rejoignirent les églises baptistes et chrétiennes évangéliques, plus développées tant sur le plan théologique qu'organisationnel.
Après le « Décret sur le renforcement des principes de tolérance » (1905), les protestants russes ont eu la possibilité d'agir plus librement. Ni la censure ni le Saint-Synode ne les ont plus empêchés. A ce stade, les ministres baptiste et évangélique I.V. se sont clairement montrés. Kargel, I.S. Prokhanov, V.M. Fetler, P.N. Nikolaï et coll.
Une liberté relative persista également dans les premières années du pouvoir soviétique. Avant le début des répressions staliniennes, les chrétiens évangéliques ont réussi à construire des lieux de culte, à fonder de nombreuses communautés et à développer un ministère actif. Mais ils n’ont jamais franchi le seuil d’une sous-culture religieuse.
Depuis les années 90 Au siècle dernier, le protestantisme en Russie a de nouveau eu la possibilité de se développer librement. Après 70 ans d’existence semi-clandestine, les croyants ont obtenu le droit de vote et la possibilité d’influencer la culture. La question s’est posée : quelle place les protestants russes sont-ils appelés à occuper dans une société post-communiste ?
Il convient de noter que la situation religieuse moderne en Russie est unique. Nous constatons un mélange bizarre de différentes tendances. D'une part, il s'agit d'une symbiose toujours croissante entre les structures officielles du député de l'Église orthodoxe russe et du pouvoir d'État, d'autre part, d'un mouvement vers une société de consommation générale et de laïcisation. Des langues acérées décrivaient la situation actuelle avec une triade légèrement modifiée du comte S.S. Uvarova : « Orthodoxie, autocratie, rentabilité. »
Des questions difficiles se posent ici pour le croyant. Quel pourrait être le dialogue entre les protestants russes et la culture moderne dominante ? Le protestantisme russe doit-il rester une sous-culture ? Et si c’est le cas, cela ne deviendra-t-il pas simplement une sorte de curiosité religieuse ? Le mode d’existence contre-culturel des protestants en Russie est-il acceptable ? Quelles formes peut-il prendre ?
Les auteurs protestants conceptualisent le but du protestantisme de différentes manières. Par exemple, le ministre luthérien A.N. Lauga a écrit : « Si la Russie ne parvient pas à devenir un pays protestant, c'est-à-dire si l'Église orthodoxe ne reconnaît pas finalement que l'apôtre Paul a raison : « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et non par vous-mêmes, cadeau de Dieu« Pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie » (Eph. 2, 8-9), s'ils ne comprennent pas enfin ce que cela signifie : « Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; et s'il y a une justification par la loi, alors Christ est mort en vain » (Galates 2 : 21), alors cet État sera à jamais une prison pour les nations et une menace pour le monde.
Bien sûr, nous voyons ici une position extrême, même si elle est périodiquement exprimée par différentes personnes même ceux qui n'appartiennent pas à l'Église protestante. Un exemple est le débat « En quoi croit un Russe en Dieu », lancé par Andrei Konchalovsky.
Une tentative plus équilibrée semble consister à considérer le protestantisme non pas comme un substitut, mais comme un parallèle à l’orthodoxie. Dans leur travail sur l’histoire du christianisme évangélique, J. Ellis et W. Jones notent : « La culture et la structure de l’Église occidentale sont aussi déplacées dans certaines régions de Russie qu’elles le seraient en Afrique centrale ou à Tokyo. Tout comme la liturgie de l’Église grecque ne répond pas aux besoins spirituels de tous les Russes en raison de leur diversité, l’organisation et les ministères de l’Église occidentale ne répondent pas aux besoins de tous les Russes. Tout comme il est vrai que l’Église russe n’a pas réussi pendant des siècles auprès des paysans des villages reculés, il est également vrai que l’Église occidentale n’a pas réussi auprès d’eux et a été ignorée par eux pendant des siècles.
Avec cette formulation de la question, la dure confrontation entre confessions est supprimée. Le protestantisme n’est pas conceptualisé comme quelque chose de superflu ou étranger à la culture russe. Il n’est pas un « morceau de tissu écru » arraché à l’Occident et cousu à la Russie.
Bien sûr, il faut ici repenser de manière créative les formes et apporter de nouvelles réponses à de nombreuses questions. Existe-t-il des traditions dans la culture russe sur lesquelles les protestants peuvent s’appuyer dans leur ministère ? Qu'est-ce qui, dans la diversité des types religieux russes, ressemble aux idées protestantes ? Quels besoins existentiels de l’âme russe sont plus proches du culte protestant ?
Comprendre ces enjeux semble extrêmement important pour l’avenir églises évangéliques en Russie. Elle a été commencée à la fin du XIXème siècle. grâce à deux interprétations du protestantisme russe - le stundisme et le pachkovisme. Il est fort possible que nous puissions bientôt assister à une nouvelle interprétation de ces formes en fonction du changement de contexte historique et culturel.
Bibliographie
1. Dostoïevski F. M. Journal d'un écrivain : en 2 volumes T. 1 / entrée. Art. I. Volgina, commentaire. V. Raka, A. Arkhipova, G. Galagan, E. Kiiko, V. Tunimanova. - M. : Livre. Club 36.6, 2011.
2. Dostoïevski F. M. Journal d'un écrivain : en 2 volumes T. 2 / commentaire. A. Batyuto, A. Berezkina, V. Vetlovskaya, E. Kiyko, G. Stepanova, V. Tunimanova. - M. : Livre. Club 36.6, 2011.
3. Histoire du mouvement baptiste évangélique en Ukraine. - Odessa : Bogomyslie, 1998.
4. Konchalovsky A.S. En quel dieu croit le peuple russe ? [Ressource électronique]. - URL : http://www.rg.ru/2013/04/10/vera.html, gratuit. - Casquette. depuis l'écran.
5. Lauga A. N. Captivité des chagrins. - Saint-Pétersbourg : Shandal, 2001.
6. Leskov N. S. Miroir de la vie. - Saint-Pétersbourg : Christ. Société « Bible pour tous »,
7. Liven S.P. Éveil spirituel en Russie. [Ressource électronique]. -URL : http://www.blagovestnik.org/books/00209.htm, gratuit. - Casquette. depuis l'écran.
8. Pobedonostsev K.P. Le grand mensonge de notre temps / comp. S. A. Rostu-nova ; entrée Art. A.P. Lanshchikova. - M. : Rus. livre, 1993.
9. Prokhanov I. Dans le chaudron de Russie. - Chicago : TOUS, 1992.
10. Ellis Jeffrey, Jones Wesley L. Une autre révolution : le réveil évangélique russe. - Saint-Pétersbourg : Vita International, 1999.
Après la frénésie de la perestroïka, la société russe s’est tournée vers Dieu. Le nombre de paroisses d'églises traditionnelles et peu russes s'est accru sous nos yeux. Certains, comme l’Église orthodoxe russe, étaient visibles en permanence, d’autres ne faisaient pas de publicité pour leurs activités. Protestants russes appartenaient à la deuxième catégorie, ce qui ne les a pas empêchés de devenir aujourd'hui la communauté religieuse qui connaît la croissance la plus rapide du pays.Pendant longtemps, le protestantisme en Russie a été le lot des minorités nationales. Les luthériens (une des branches du protestantisme) étaient pour la plupart des Allemands russifiés et des peuples des États baltes. En 1832, le luthéranisme allemand obtient le statut de religion d’État. Avec l'entrée dans l'Empire russe de Finlande, les luthériens finlandais furent inclus dans le nombre de sujets russes. Fin du 19ème siècle. Le baptiste, nouvelle direction du protestantisme à cette époque, commença à pénétrer en Russie. Les baptistes étaient plus enclins que les autres à mener des activités missionnaires auprès de la population, ce qui, bien entendu, n'était pas approuvé par l'État, dont la religion officielle était l'orthodoxie. Puis s’est développée une certaine tradition de confrontation entre les baptistes et l’Église dominante (orthodoxe). Le fait est que les baptistes considèrent les chrétiens orthodoxes baptisés, mais non pratiquants, comme des « chrétiens de nom » qui peuvent et doivent être acceptés dans leurs rangs. En conséquence, un grand nombre de sujets russes se sont retrouvés dans le champ des efforts missionnaires des prédicateurs baptistes.
À l’époque soviétique, les communautés protestantes, comme toutes les autres associations religieuses, ont subi l’oppression de l’appareil répressif de l’État. Environ la moitié des baptistes sont entrés dans la clandestinité parce qu’ils considéraient l’enregistrement des communautés par l’État comme « le sceau de Satan ». Avec la perestroïka et l'annonce des libertés religieuses, les communautés baptistes sont légalisées et commencent à se multiplier. Il convient de noter que les baptistes ne sont pas unis. La partie la plus active de leurs associations religieuses sont les pentecôtistes, qui diffèrent des baptistes classiques. À l'époque soviétique, les pentecôtistes enregistrés étaient contraints de rejoindre une seule structure sociale avec les autres baptistes, ce qui les rendait plus faciles à contrôler. Cependant, avec la fin du système soviétique, les pentecôtistes se sont rapidement dissociés des autres.
Il est assez difficile de dire combien de pentecôtistes il y a aujourd’hui dans le pays. Dans l'Église russe des chrétiens de foi évangélique (pentecôtistes), ils m'ont donné le chiffre de 300 000 personnes. Dans des conversations privées, ils parlent d'autres données - de 400 000 à 1 million. Un fait révélateur : ce sont les pentecôtistes qui ont réussi à organiser le rassemblement de protestation le plus massif de ces derniers temps à Moscou. Cet été, plus de 500 personnes d'une organisation religieuse pentecôtiste se sont rassemblées dans le centre de la capitale pour protester contre le fait qu'on ne leur avait pas attribué de terrain pour un temple depuis longtemps. Les médias d’État sont restés timidement silencieux sur l’action civile des croyants, mais celle-ci a eu un large écho au sein de la communauté protestante russe.
Lors du premier congrès général des pentecôtistes en 1990, seuls 56 associations et groupes religieux étaient enregistrés. Aujourd’hui, ils sont plus de deux mille. En plus de Moscou, il existe de nombreuses communautés protestantes en Sibérie - là-bas, dans certaines régions, le nombre de protestants est presque égal au nombre de chrétiens orthodoxes. Parmi ceux inscrits dans communautés religieuses, Certainement.
Nous avons discuté avec plusieurs experts des raisons de la popularité du protestantisme, ainsi que des perspectives de son développement en Russie. L'érudit religieux Alexandre Vladimirovitch Chchipkov a été l'un des premiers à faire, il y a 10 ans, une prévision sur la croissance du nombre de protestants, en particulier de pentecôtistes. Il donne à cela une explication plutôt inattendue : "Les pentecôtistes ont un élément d'exaltation dans leurs rituels. En Russie, il y a suffisamment de gens enclins à cela. Rappelez-vous les massives sectes russes des Khlysty, Skoptsy et Jumpers dans le passé. Et puisque, de tous les chrétiens, ce sont les pentecôtistes qui occupent cette niche spécifique et détiennent le monopole de la forme de culte exaltée, alors les gens enclins à une telle exaltation y iront toujours. ». Parlant des perspectives, Alexandre Vladimirovitch affirme que le mouvement protestant ne deviendra pas massif dans un avenir proche, mais qu'il se développera quantitativement et, surtout, qualitativement, en augmentant le niveau d'éducation des croyants.
Le curé de la paroisse Saint-Jean le Théologien de l'Église évangélique luthérienne d'Ingrie (luthériens de rite finlandais), Konstantin Andreev, estime également que la croissance numérique des protestants va se poursuivre. Certes, quant aux luthériens eux-mêmes, qui ne sont que 15 000, ils regardent les choses avec sobriété, mais « nous sommes heureux de croire que nous restons l'Église de la minorité pensante », a conclu le pasteur.
Pavel Anatolyevich Bak, premier évêque en chef adjoint de l'Église russe des chrétiens de foi évangélique (pentecôtistes), est convaincu que le protestantisme russe a des perspectives, et voici pourquoi : "Le protestantisme russe est supranational, puisque le Seigneur a dit : "Je créerai ma propre Église", sans donner la priorité à quiconque en fonction de sa nationalité ou de sa religion. Cela est étranger à l'esprit de l'Évangile".. Il n'y a pas d'enthousiasme pour l'adoption du protestantisme, a poursuivi Pavel Anatolyevich, mais il y a une croissance dynamique et confiante des communautés. Les raisons du succès résident dans le phénomène de l’existence russe : les peuples russes sont attirés par le maintien d’un sentiment d’identité collective et de bon voisinage, alors que le monde d’aujourd’hui devient de plus en plus individualiste. Selon Buck, les pentecôtistes entretiennent de bonnes relations de voisinage et prêchent sur l'expérience personnelle de communication avec Dieu, où les miracles font partie intégrante de la perception de Dieu.
Il y a quelques années, en Lettonie, pays voisin de la Russie, on a décidé de compter le nombre des croyants. Ils ont fait le calcul et ont été stupéfaits par les résultats. Dans un pays traditionnellement protestant, le nombre de chrétiens orthodoxes dépassait le nombre de protestants. Nous avons commencé à découvrir ce qui se passait, et il s'est avéré que les Lettons russophones (pas seulement les Russes de nationalité) se considèrent orthodoxes au moins en vertu du baptême, et les Lettons se considèrent comme protestants uniquement s'ils vont régulièrement à l'église et se produisent. rituels quotidiens. Pourquoi fait-on ça?
La Russie est considérée comme un pays orthodoxe, même si nous comptons à peine un dixième de tous les baptisés qui vont régulièrement à l'église (l'un des experts a récemment annoncé un chiffre de 4 % de croyants par rapport au nombre de baptisés). Il se peut que dans quelques décennies, voire avant, « l’effet Lettonie » se manifeste. Autrement dit, la majorité formelle des baptisés restera orthodoxe et la majorité des croyants seront protestants. Que ce soit bon ou mauvais, Dieu seul le sait.